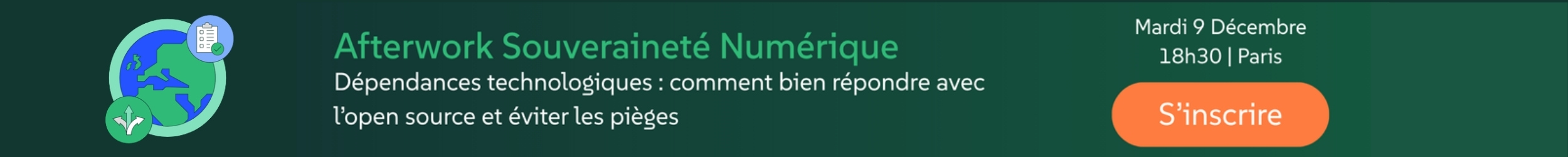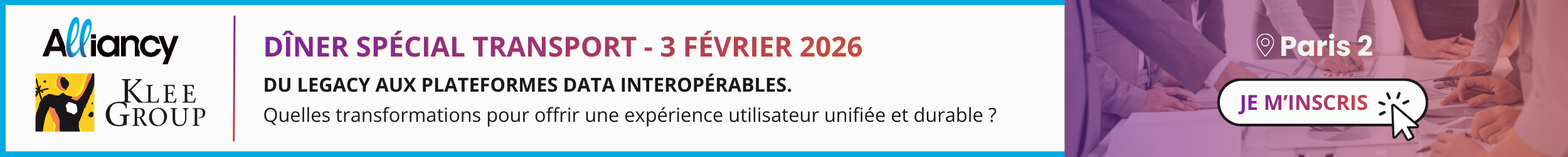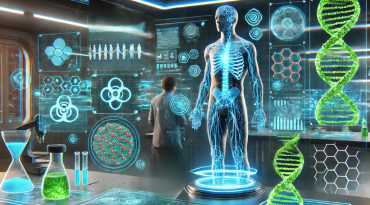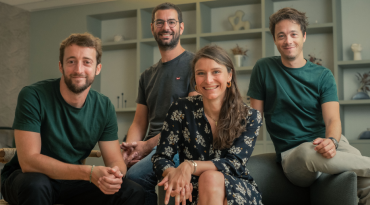Sylvain Staub (à gauche) et Jean-Baptiste Belin, avocats au sein du cabinet Staub & Associés
L’arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la Cour d’appel de Bordeaux est le dernier épisode de la saga judiciaire opposant la MAIF à IBM suite à l’échec d’un projet d’intégration de progiciel.
L’échec des projets informatiques génère parfois des contentieux aux longs cours car la matière, en plus d’être technique, imbrique étroitement les responsabilités du prestataire et du client lors de la conduite du projet. En pratique, le recours à l’expertise est donc souvent inévitable sans pour autant être une garantie de prévisibilité quant à l’issue du litige. Ainsi, dans la célèbre affaire IBM/MAIF, un même rapport d’expertise a donné lieu à trois décisions de justice radicalement opposées.
Un projet d’intégration classique
Par contrat d’intégration en date du 14 décembre 2004, IBM s’engage à fournir à la MAIF, en qualité de « maître d’œuvre » et sur la base d’une obligation de résultat, une solution de gestion de la relation sociétaires intégrée (progiciel édité par Siebel) conforme au périmètre fonctionnel et technique convenu, avec un calendrier impératif et en contrepartie d’un prix forfaitaire ferme et définitif (plus de sept millions d’euros).
Le projet s’enlise rapidement et fin 2005, IBM et la MAIF concluent deux « protocoles », évoquant le décalage du calendrier et l’augmentation du budget (porté à plus de 11 millions d’euros). Ayant refusé la refonte du projet avec un budget doublé (une vingtaine de millions d’euros), la MAIF met en demeure IBM d’exécuter le contrat d’intégration et obtient en référé la désignation d’un expert.
En réponse, IBM l’assigne en règlement des factures impayées (environ 9 millions d’euros) tandis que pour sa défense, la MAIF demande la nullité du contrat d’intégration et l’indemnisation de son préjudice estimé à près de 20 millions d’euros.
Un match à l’issue indécise
En première instance, le tribunal annule le contrat pour dol au motif qu’IBM a délibérément caché les risques inhérents au projet pour mieux remporter le marché (TGI Niort, 14 décembre 2009). IBM est aussi jugé défaillant à son obligation de conseil au motif que la MAIF a été maintenue dans l’illusion que le projet pouvait être réalisé aux conditions initiales. Au final, IBM verse à la MAIF 9 millions d’euros de dommages et intérêts en plus de la restitution des sommes reçues en paiement des factures (environ un million et demi d’euros).
Ce jugement très sévère à l’encontre d’IBM est infirmé en appel (Cour d’appel de Poitiers, 25 novembre 2011) : le contrat d’intégration est, cette, fois jugé valable car la MAIF, qui dispose d’une division informatique étoffée et n’est pas un profane de l’informatique, avait une bonne connaissance des risques du projet, y compris en phase d’avant-vente.
Conformément au rapport d’expertise, aucun manquement d’IBM à son obligation de conseil n’est donc caractérisé en l’espèce. De plus, la responsabilité d’IBM n’est pas non plus engagée malgré l’absence de livraison des prestations commandées, les « protocoles » signés en 2005 se substituant au contrat d’intégration initial. Par conséquent, c’est la MAIF qui est ici condamnée à payer environ 4 millions d’euros pour les prestations d’IBM.
Sur pourvoi de la MAIF, cette décision est censurée par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 1273 du code civil, selon lequel « la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte » (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juin 2013). En d’autres termes, la Cour d’appel ne caractérise pas avec évidence la volonté non-équivoque de la MAIF de substituer « purement et simplement » au contrat d’intégration les protocoles signés en cours de projet. Tout reste donc à faire dans un nouveau recours.
Une victoire de la MAIF par KO ?
L’arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la Cour d’appel de Bordeaux consacre la pleine effectivité du contrat d’intégration initial. D’une part, la nullité est écartée en l’absence de réticence dolosive commise par IBM : la MAIF s’appuyait sur une direction informatique importante et connaissait bien l’ampleur les difficultés et les risques du projet « notamment en termes de dépassement de délais et de coûts ». Elle n’a donc pas pu être induite en erreur par IBM, dont la rétention d’information n’est d’ailleurs établie à aucun moment, lors de l’avant-vente ou pendant le projet.
D’autre part, les protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005 n’ont cette fois aucune valeur contractuelle, faute d’avoir été suivis « d’une nouvelle convention se substituant à la première, ou même des avenants ». Pour la Cour, il s’agit de documents préparatoires qui « n’ont pas donné lieu à la souscription d’engagements fermes aux termes desquels la MAIF aurait consenti à un étalement du calendrier et surtout à une révision du forfait convenu ». Ils étaient donc sans effets sur les engagements initiaux stipulés dans le contrat d’intégration.
Or, selon ce contrat, IBM avait l’obligation de fournir, en qualité de « maître d’œuvre » et sur la base d’une obligation de résultat, une solution intégrée conforme au périmètre fonctionnel et technique convenu entre les parties, en respectant un calendrier impératif et en contrepartie d’un prix forfaitaire. En l’absence d’atteinte du résultat promis dans les délais et en contrepartie du prix convenu, la responsabilité d’IBM ne pouvait donc qu’être engagée, en l’espèce à hauteur d’environ 6,5 millions d’euros de dommages-intérêts en réparation des sommes dépensées en pure perte et du préjudice de la MAIF du fait du retard du projet.
Les enseignements pratiques à tirer
L’intérêt principal de cette décision réside dans l’évolution des documents contractuels en cours de projet, la primauté du contrat d’intégration initial sur les protocoles signés en cours de projet ayant été fatale à IBM faute d’avoir pu respecter ses engagements initiaux.
En effet, si le contrat signé entre les parties en début du projet possède force obligatoire et constitue la « loi des parties » (article 1134 du Code civil), l’accord initial sort rarement indemne d’une conduite du projet souvent empreinte de pragmatisme. Ainsi, les projets informatiques au forfait contiennent forcément un risque de dérive compte tenu des aléas inhérents à la conduite du projet par le prestataire (sous-estimation des tâches, compréhension partielle des besoins du client, ressources insuffisantes) et le client (absence de collaboration, non-respect des délais de validation des livrables, modification du périmètre et évolution de besoins).
En pratique, les équipes procèdent donc nécessairement à des arbitrages et à des modifications de projet au sein des instances de gouvernance, l’idée étant d’entériner les ajustements nécessaires et de liquider les désaccords pour pouvoir délivrer le projet. La difficulté réside alors dans la formalisation de ces accords, étape indispensable pour leur conférer une pleine valeur juridique et modifier le contrat initial. En effet, il est parfois difficile de retrouver la volonté des parties entre le contrat initial d’une part, et les comptes rendus de comité de pilotage, les échanges opérationnels entres les équipes du client et celles du prestataire et/ou les avenants successifs d’autre part, ces documents ayant tous vocation à acquérir une valeur contractuelle si telle a été la volonté des parties.
Par conséquent, il est juridiquement impératif de formaliser l’évolution du projet par la signature d’avenants précisant sans ambiguïté le remplacement d’obligations anciennes par de nouvelles obligations, le maintien des clauses du contrat initial demeurant inchangées, voire l’abandon d’un droit à réparation issu de litiges antérieurs. La passation d’avenants est toujours un exercice périlleux imposant d’examiner minutieusement le passé pour organiser l’avenir : à défaut, le contrat initial continuera d’être le seul référentiel contractuel aux yeux du juge, pour qui les arbitrages opérationnels n’auront aucune valeur juridique.
Lire aussi : Le SaaS devant les tribunaux

 Tech In Sport
Tech In Sport Green Tech Leaders
Green Tech Leaders Alliancy Elevate
Alliancy Elevate International
International Nominations
Nominations Politique publique
Politique publique